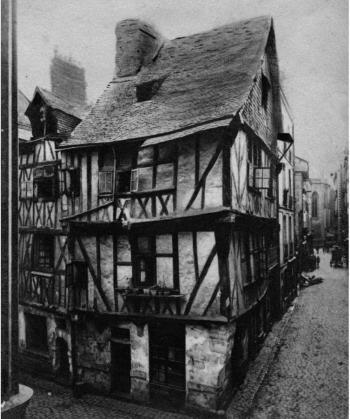Rétablir le culte réformé à Nantes sous les contraintes de l’Édit…
Nous poursuivons ici la transcription de l’ouvrage de Benjamin Vaurigaud, Histoire de l’Église Réformée de Nantes, paru en 1880 et devenu très rare. Cette transcription concerne le chapitre 6 et les pages 132 à 142 du livre. Nous avons ajouté quelques sous-titres.
Où inhumer les défunts ?
Arrivés à Nantes dans le courant de février, les commissaires de l’Édit se mirent aussitôt à l’oeuvre pour assurer un lieu de sépulture et un lieu de culte aux Réformés de cette ville. Le 27 février 1601, le maire fit connaître au bureau « l’arrivée de M. Turcan et celle de M. Kergrois d’Avaugour ; qu’il avait appris de M. Turcan lui-même le but de leur venue et l’intention où ils étaient de présenter au bureau les lettres-patentes du roi adressées à la ville et relatives à leur mission ». Le bureau décida d’attendre la communication de ces lettres pour fixer la date d’une assemblée extraordinaire dans laquelle on aviserait à prendre le parti qui semblerait le plus avantageux pour le bien de la ville et le service du roi. Ces lettres furent communiquées et lues au bureau le 24 du même mois. Elles étaient écrites de Lyon en date du 19 juillet précédent et donnaient aux commissaires « plein pouvoir de faire assembler les officiers de sa dite majesté, tant ecclésiastiques que principaux de la noblesse et corps de ville, pour leur déclarer le contenu de l’édit de Nantes, et leur en faire promettre et jurer à tous l’observation ».
Après avoir entendu la lecture de ces lettres, il fut advisé « qu’à l’issue de céans, Messieurs se transporteront à l’évêché pour trouver M. de Nantes sur ce sujet1 ». De leur côté, les commissaires, en exécution de leur mandat, firent assembler les officiers ecclésiastiques, maire et eschevins et gentilshommes, et autres faisant profession de ladite religion Réformée, les ont fait lever la main, jurer et promettre à Dieu et au roi, garder inviolablement et observer en leur particulier et faire observer et garder ce qui dépendait de leurs charges, ceux qui en avaient, ledit Édit.
Après quoi on s’occupa de choisir d’abord des terrains pouvant servir de cimetières ; chaque lieu indiqué provoquait des oppositions et des remontrances. C’est ainsi que, du côté de Saint-Clément, le choix des commissaires ayant paru devoir s’arrêter sur un endroit de la motte Saint-André, près de la croix (Travers remarque qu’il y avait alors deux croix sur cette motte : une à l’entrée, et l’autre à la fin ; la dernière était à peu de distance de la rue Saint-André). Les paroissiens de Saint-Léonard s’y opposèrent, alléguant que c’était là leur propre cimetière. Des difficultés de même nature ayant été faites sur tous les autres endroits indiqués, le commissaire résolut d’en déterminer un, en vertu de son autorité, an bas de la motte Saint-André, vis-à-vis le fort de Mercoeur.
C’est l’opinion de l’abbé Travers que là fut, en effet, le cimetière des Réformés. Mais, un procès-verbal du 2 avril 1604, mentionné dans une pièce de procédure de 1664 et relative à une contestation au sujet des cimetières, conduit à une conclusion différente. Il est dit en effet : « que sur la demande desdits de la religion de trois lieux d’enterrement, les commissaires ayant fait assembler les sieurs maire et eschevins de ladite ville, et syndic des habitants d’icelle, qui, après avoir été ouïs sur les empêchements qu’ils prétendaient faire à ladite demande desdits de la religion, à ce qu’il ne leur fut donné qu’un lieu d’enterrement pour tous ceux qui décéderaient dans ladite ville et faubourg de Nantes, les moyens des plaignants bien au long et à diverses fois déduits, lesdits sieurs commissaires, assistés de messieurs le sénéchal, lieutenant et procureur du roi en ladite ville de Nantes, en présence des suppliants, ayant par plusieurs fois descendu sur les trois lieux, que lesdits de la religion demandaient pour l’enterrement de leurs morts, auraient enfin, en la présence desdits sieurs officiers et ceux-ci ouïs, ordonné trois lieux d’enterrement à ceux de la religion, savoir : le premier en la ville de Nantes, marqué, spécifié et déborné auprès du cimetière des pauvres de l’hôpital Sainte-Catherine ; le second au Marchix qui est la quantité de huit toises de terre en carré à prendre à une place située en la ville neuve et près la porte appelée la Porte-de-Couëron, aussi déborné ; le troisième au-dessus des faubourgs de Richebourg, de la quantité de six toises de terre en longueur sur quatre de largeur, à prendre au bout d’une pièce de terre appartenant, cedit trois (troisième terrain) à Me Jean Bernard, procureur au siège de ladite ville, ladite quantité de six toises de terre auparavant achetée dudit Bernard, par ledit syndic des habitants de ladite ville, pour être employée à l’effet dudit cimetière. Icelui lieu aussi déborné, avec défense à toutes personnes de troubler et empêcher lesdits de la R. P. R en l’usage et libre jouissance desdits trois lieux d’enterrement sur les peines ordonnées contre les rebelles criminels de lèse-majesté, infracteurs de paix et perturbateurs du repos public ».
Il semble, qu’entourée de pareilles garanties de maturité, de légalité et d’accord, la jouissance de ces cimetières n’aurait dù rencontrer aucune entrave ; mais nous verrons dans la suite, qu’en 1664, les Réformés n’avaient pas pu entrer en possession du cimetière du Marchix et de Richebourg.
Si l’on s’en tient au nombre des Réformés de Nantes à cette époque, il semble que la désignation de trois lieux de sépulture n’était pas en rapport avec le chiffre de la population, et que les habitants ne se montraient pas déraisonnables en n’en voulant concéder qu’un. Mais, si l’on tient compte de l’état de dissémination où se trouvaient ceux de la religion, de la distance qu’il y avait à franchir, dans la plupart des cas, pour se rendre au cimetière, et surtout de l’animosité du plus grand nombre des habitants contre eux, on comprendra qu’il devait en être autrement. Il y avait intérêt, pour la paix publique, pour le support entre les partisans des deux cultes et pour éviter les troubles et les séditions, d’abréger le parcours des enterrements pour se rendre aux cimetières, et, dans en but, à ne pas se contenter d’un seul.
On en peut juger par ce qui eut lieu quelques mois plus tard. En effet, l’irritation était grande dans les esprits parmi le peuple, et elle y était entretenue par ceux-là même qui auraient dû en procurer l’apaisement. C’est ainsi que les Réformés se plaignirent au roi que, contrairement à la teneur de l’article 17 de l’Édit, « plusieurs prédicateurs et avocats aux cours de Parlement et notamment en Bretagne dans différents sièges de leur ressort se licenciaient journellement de tenir propos scandaleux, appelant ceux de ladite religion hérétique, exhortant les enfants et menu peuple à leur dire des injures et les brocarder lorsqu’ils vont ou reviennent de l’exercice de leur religion ».
On comprend dès lors ce qui devait arriver quand un enterrement traversait pendant un certain temps les rues de la ville avant d’arriver au cimetière. Un ancien du consistoire nommé Geslin, qui, dès les débuts de la Réforme à Nantes, avait eu à souffrir pour sa foi et avait acquis une assez grande notoriété, étant venu à mourir, une sédition éclata dans la ville à l’occasion de sa sépulture. Les troubles furent d’une telle gravité que le gouverneur pour les réprimer et pour en éviter le retour dut faire punir exemplairement les coupables. Ce qui n’est pas moins remarquable que cette fermeté déployée pour la protection des Réformés, c’est l’approbation publique que le roi lui-même y donna. En effet, ayant été informé de la vigueur et de l’énergie avec lesquelles l’ordre et la tranquillité avaient été rétablis entre les citoyens, il en félicita la ville et le gouverneur.
Où trouver des lieux de culte acceptables ?
Le choix d’un lieu de culte pour les Réformés de Nantes donna lieu aussi à de difficiles négociations. Enfin les commissaires désignèrent Sucé comme premier lieu de bailliage de la sénéchaussée de Nantes, puisqu’aux termes de l’Édit on ne pouvait en avoir un ni dans la ville, ni dans les faubourgs. L’endroit spécial de Sucé où le culte devait être célébré était la tenue de Jullien Bernard, dite tenue du Ruisseau, parce qu’il y avait là un ruisseau par où l’eau du chemin s’écoulait dans I’Erdre. Cet endroit était éloigné de cent cinquante toises (trois cents mètres environ) de l’église paroissiale de Sucé, détaché hors du bourg et dans le proche fief du seigneur de Procé. Il y avait là une grange où ils se réunirent pendant vingt-cinq ans. Sucé est à trois lieues de Nantes. On se représente sans peine les difficultés qu’il y avait pour les Réformés à se rendre au culte avec une pareille distance à parcourir chaque dimanche.
Sous le régime de l’Édit, les synodes se réunirent fréquemment, quoiqu’il fût toujours nécessaire d’en obtenir l’autorisation du roi, qui n’y faisait pas d’ordinaire de sérieuses difficultés. Il en était autrement des assemblées politiques qui lui portaient ombrage comme usurpant, ou du moins pouvant en venir à usurper sur son autorité. Il fallut aux Églises une grande persévérance dans leurs demandes et dans leurs plaintes pour triompher de ce mauvais vouloir ou de cette clairvoyance du roi qui, dans tous les cas, était en opposition formelle avec le droit des Réformés expressément reconnu par l’Édit.
Dans ces deux sortes d’assemblées, l’Église de Nantes fut dignement et même brillamment représentée. Ainsi, au Synode de Gap (octobre 1603), son pasteur, François Oyseau, fut un des députés pour la Bretagne, et le Synode lui confia la mission de rechercher si les actes et papiers des Synodes nationaux précédents étaient à Vitré. Dans les Synodes de La Rochelle (mars 1606), de Saint-Maixent (mai 1609), un ancien de son Consistoire, Louis d’Avaugour, sieur du Bois de Kergrois, fut également député pour la Bretagne. Le brevet qui permettait la tenue du Synode de Gap ne semblait pas lui reconnaître le pouvoir de donner des instructions aux nouveaux députés généraux, ni de donner décharge aux anciens qui s’étaient présentés devant lui, le Synode envoya une députation en cour « pour représenter au roi, en toute humilité, les inconvénients dudit brevet. » Louis d’Avaugour fut nommé dans ce but avec le pasteur Gigord.
On n’avait obtenu qu’avec peine la réunion d’une assemblée politique à Châtellerault (juillet 1605) ; les provinces avaient dû présenter des mémoires dans ce but, et, pour la Bretagne ceux qu’avait rédigés le pasteur de Nantes étaient signalés comme pleins de hardiesse. D’Avaugour figure comme député de la Bretagne à cette assemblée. Le roi, en autorisant la réunion, avait déterminé d’avance le mode de nomination des députés généraux et la durée de leurs fonctions. L’assemblée présentait une liste dans laquelle le roi choisissait les députés. D’Avaugour fut l’un des candidats pour la noblesse. Le roi ne le nomma point, mais le fait seul de sa présentation est une preuve de l’estime de ses coreligionnaires. A l’Assemblée politique de Grenoble (juillet 1695), il représentait encore la Bretagne.
Ce Louis d’Avaugour était fils de René qui recevait chez lui à La Rochelle, les débris des Églises bretonnes pendant la Ligue, et qui était l’un des membres les plus pieux et les plus considérables de cette Église du Refuge. L’Église de Nantes trouva donc dans la famille d’Avaugour comme dans la famille de la Muce, pendant bien des années, à la fois de grands exemples et un concours très efficace et très dévoué. Ces Assemblées politiques étaient dans l’ordre civil ce qu’étaient les Synodes dans l’ordre ecclésiastique et religieux, une autre application du gouvernement représentatif dont notre Église a fait usage trois siècles avant les essais des nations les plus libérales d’Europe. L’Assemblée politique se composait des députés des Conseils provinciaux comme le Synode national de ceux des Synodes provinciaux. Ill y avait la même analogie dans leurs attributions respectives.
Depuis la mort du roi, la tendance de la cour avait été d’interpréter et d’appliquer, dans un sens restrictif, tous les articles de l’Édit concernant les Réformés. De là, chez ces derniers une défiance et des craintes qui n’étaient que trop motivées. On en eut dans ce temps (1614) une nouvelle preuve à Nantes. Après une longue procédure dont l’origine remontait à l’année 1572, la famille de la Muce avait obtenu, le 29 mars 1585, malgré l’opposition de la ville de Nantes, un arrêt du Parlement de Rennes qui ordonnait la publication et l’enregistrement des lettres patentes qui érigeaient en châtellenie la seigneurie du Plessis, du Bois et de la Muce, mais à la condition que le seigneur de la Muce n’y pourrait bâtir château ni forteresse, ni y faire l’exercice de la religion. Mais la Ligue d’une part, et l’opposition de la Chambre des Comptes de l’autre, empêchèrent l’exécution de cet arrêt. Ce ne fut que le 27 juin 1598 que la Chambre des Comptes vérifia et entérina les lettres-patentes du mois d’août 1572, et encore, en le faisant, prit-elle soin d’ajouter qu’ayant égard à l’opposition des habitants, c’était à la charge que la maison du Plessis du Bois-de-la-Muce ne serait point fortifiée et qu’il n’y serait fait aucun exercice du culte, ni aucune Assemblée de ceux de la religion.
En 1614, la douairière de La Muce, se fondant sur l’article 76 de l’Édit de Nantes et sur l’article 32 des articles particuliers du même Édit, qui permettaient aux seigneurs hauts justiciers de faire faire le culte dans leur maison, pourvu qu’ils y fissent, eux ou leur famille, leur principale résidence, le fit célébrer dans sa maison du Plessis La Muce. Aussitôt, les catholiques de Nantes s’émurent et renouvelèrent leurs démarches et leurs réclamations, ils obtinrent un arrêt du Conseil d’État de suspendre tout exercice du culte jusqu’à ce qu’il en ait été autrement ordonné. Les parties furent assignées de nouveau devant le Conseil par un arrêt du 13 novembre.
Des lettres de remerciement, adressées par les maire et échevins à diverses personnes dont l’influence avait fait obtenir un heureux résultat dans l’affaire contre Madame de La Muce, prouvent que le Conseil se prononça en faveur de la ville.
(A suivre…)
1Appellation de l’évêque du lieu